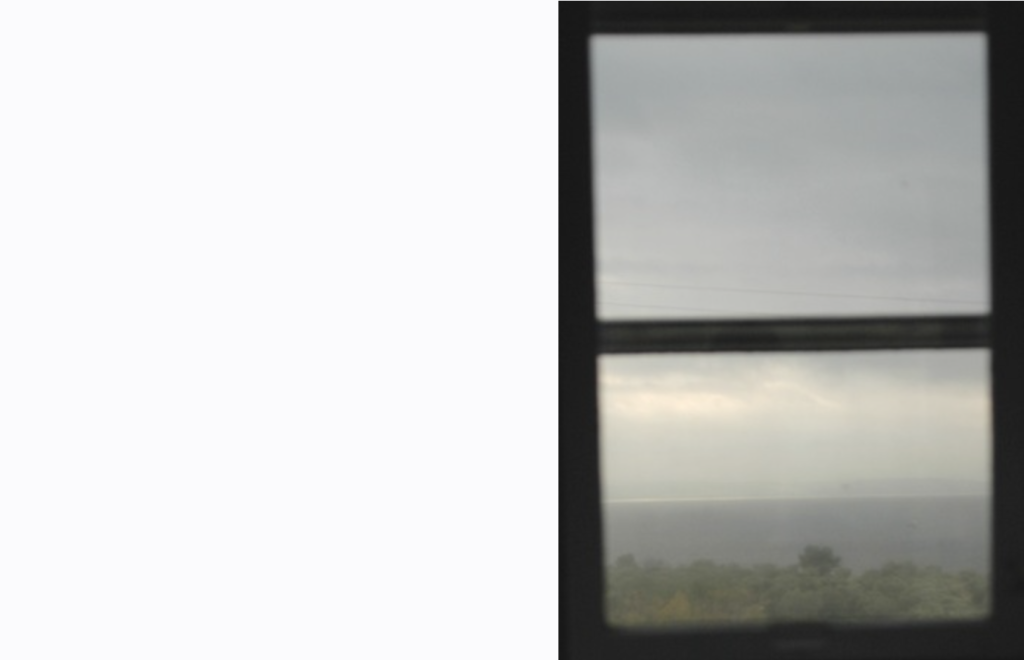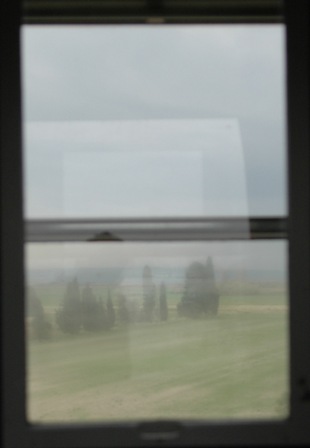
Ce projet est né en 2006 suite à la visite de deux expositions traitant de la
photographie de paysage naturel : la présentation de la série Landscape
d’Helena Brotherus à la galerie Fabienne Leclerc et la rétrospective de l’œuvre
du photographe américain Stephen Shore au musée du Jeu de Paume.
Face à un paysage naturel, le photographe plasticien est confronté à un
certain nombre de contraintes pour se réapproprier le réel . Ce champ
photographique est très connoté à une pratique amateur du touriste et
professionnelle du reporter de voyage. La production et l’acceptation du cliché
sont très souvent liées à la recherche du « beau » conduisant ainsi à un
formalisme assez pauvre et restreint.
Est-ce pour autant que ce champ photographique est condamné à
restituer un constat de beauté sans toute autre considération ? Autrement dit
faut-il faire fi de tout rendu d’un ressenti et d’une expérience lorsqu’il s’agit de
restituer par le média photographique la réalité du beau d’un paysage naturel ?
Ainsi, en intégrant la dimension de processus aussi bien affectif que
physique de contemplation par le spectateur, de nouvelles approches formelles
peuvent être envisagée de restitution du paysage naturel par le média
photographique.
Au constat, à l’état des lieux de la « beauté » d’un paysage naturel
peuvent venir se surajouter l’affectif du spectateur. Face à une photographie de
paysage, le spectateur éprouve un sentiment de plaisir en se référent à son
histoire personnelle de paysages rêvés et/ou vécus. Si celui-ci peut être
retransmis de manière inhérente à l’objet photographique, il convient que sa
formalisation est possible.
De manière générale, le regard est une activité mettant en jeu des
processus physiques musculaires permettant d’ajuster et de faire la mise au point
sur l’objet regardé. Ce processus physique inhérent à l’activité de regarder participe au ressenti du spectateur face à un paysage naturel. Les stimuli
musculaires sont intégrés au même titre que les informations de couleur et de
forme au niveau du système nerveux central afin de restituer une impression
un sentiment de plaisir associé à la vision. Dans certaines circonstances
particulières ce processus physique participe même pour une part très
importante au ressenti procuré par le paysage naturel : le plaisir de l’apaisement
dû à l’absence d’accommodation de l’œil en regardant l’horizon,
l’automobiliste partagé entre la conduite et la contemplation, le passager du
train ajustant son regard à travers la vitre parsemée de gouttelettes un jour
pluvieux ou tapissée de reflets un jour ensoleillé, la nuit.
Cet ensemble de travaux photographiques s’intéresse à l’expérience
intégrative du paysage naturel tel que le connaît le regardant en condition
réelle. Considérer la contemplation d’un paysage naturel en intégrant le
contexte et les processus effectifs mis en jeu pour le regarder offre une autre
manière de justifier sa restitution photographique. Ici, le spectateur de la
photographie est soit placé dans des contextes où le ressenti dû au processus
physique d’accommodation occupe une part importante du ressenti final, soit
face à une étape intermédiaire de l’acte de regarder normalement négligée
par la photographie de paysage naturel car considérée comme périphérique
ou parasite. Même si le critère du « beau » peut animer et justifier la démarche
photographique, ce « beau » ne réside plus seulement dans le seul état du lieu.
Cette autre approche intégrative confère une portée hyperréaliste
universelle rapprochant ainsi la photographie de paysage naturel des autres
champs de la photographie plasticienne plus riches en formalisme.
Elle se justifie aussi dans une contemporanéité sociale. Cette restitution du
paysage naturel rend compte du changement actuel des relations visuels de
l’homme à la nature. Celles-ci se sont raréfiées et s’effectuent le plus souvent lors
de migrations occasionnelles de la ville vers la campagne où se trouve la famille. Le paysage naturel est vu du train, de la voiture, dans un contexte où la
part du processus physique dans le ressenti est importante.
Yann Davenet, 2006